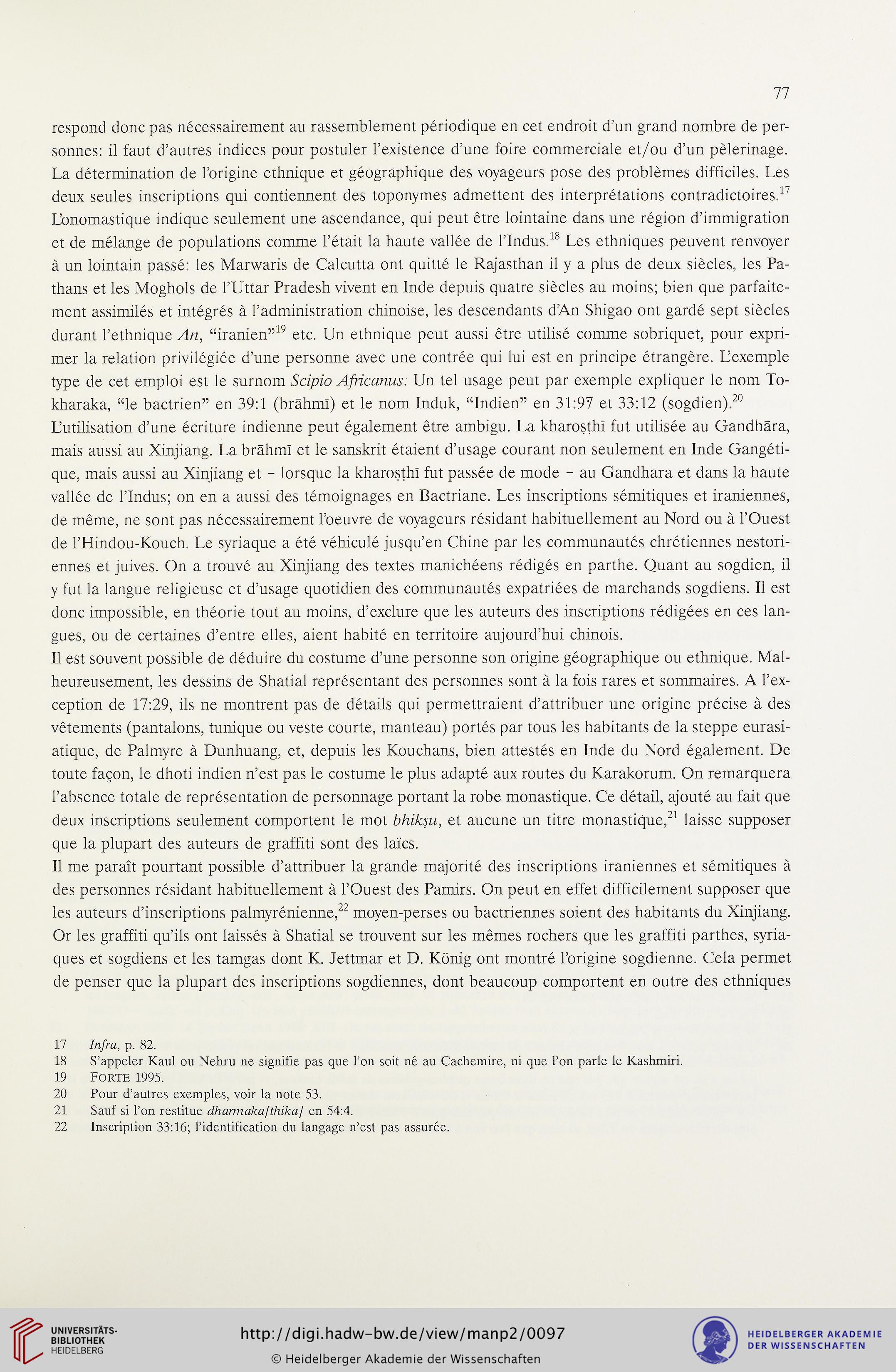77
respond donc pas necessairement au rassemblement periodique en cet endroit d'un grand nombre de per-
sonnes: il faut d'autres indices pour postuler l'existence d'une foire commerciale et/ou d'un pelerinage.
La determination de l'origine ethnique et geographique des voyageurs pose des problemes difficiles. Les
deux seules inscriptions qui contiennent des toponymes admettent des interpretations contradictoires.^
Lonomastique indique seulement une ascendance, qui peut etre iointaine dans une region d'immigration
et de melange de popuiations comme l'etait la haute valiee de l'Indus.^ Les ethniques peuvent renvoyer
ä un lointain passe: ies Marwaris de Caicutta ont quitte ie Rajasthan ii y a plus de deux siecles, les Pa-
thans et les Moghols de l'Uttar Pradesh vivent en Inde depuis quatre siecles au moins; bien que parfaite-
ment assimiles et integres ä l'administration chinoise, les descendants dAn Shigao ont garde sept siecles
durant l'ethnique "iranien"^'^ etc. Un ethnique peut aussi etre utilise comme sobriquet, pour expri-
mer la relation privilegiee d'une personne avec une contree qui lui est en principe etrangere. Lexemple
type de cet emploi est le surnom Un tel usage peut par exemple expliquer le nom To-
kharaka, "le bactrien" en 39:1 (brähmi) et le nom Induk, "Indien" en 31:97 et 33:12 (sogdien).
Lutilisation d'une ecriture indienne peut egalement etre ambigu. La kharosthl fut utilisee au Gandhära,
mais aussi au Xinjiang. La brähmi et le sanskrit etaient d'usage courant non seulement en Inde Gangeti-
que, mais aussi au Xinjiang et - lorsque la kharosthl fut passee de mode - au Gandhära et dans la haute
valiee de l'Indus; on en a aussi des temoignages en Bactriane. Les inscriptions semitiques et iraniennes,
de meme, ne sont pas necessairement l'oeuvre de voyageurs residant habituellement au Nord ou ä l'Ouest
de l'Hindou-Kouch. Le syriaque a ete vehicule jusqu'en Chine par les communautes chretiennes nestori-
ennes et juives. On a trouve au Xinjiang des textes manicheens rediges en parthe. Quant au sogdien, il
y fut la langue religieuse et d'usage quotidien des communautes expatriees de marchands sogdiens. 11 est
donc impossible, en theorie tout au moins, d'exclure que les auteurs des inscriptions redigees en ces lan-
gues, ou de certaines d'entre eiles, aient habite en territoire aujourd'hui chinois.
11 est souvent possible de deduire du costume d'une personne son origine geographique ou ethnique. Mal-
heureusement, les dessins de Shatial representant des personnes sont ä la fois rares et sommaires. A l'ex-
ception de 17:29, ils ne montrent pas de details qui permettraient d'attribuer une origine precise ä des
vetements (pantalons, tunique ou veste courte, manteau) portes par tous les habitants de la steppe eurasi-
atique, de Palmyre ä Dunhuang, et, depuis les Kouchans, bien attestes en Inde du Nord egalement. De
toute fagon, le dhoti indien n'est pas le costume le plus adapte aux routes du Karakorum. On remarquera
l'absence totale de representation de personnage portant la robe monastique. Ce detail, ajoute au fait que
deux inscriptions seulement comportent le mot b/u'kyn, et aucune un titre monastique,^ laisse supposer
que la plupart des auteurs de graffiti sont des lai'cs.
11 me parait pourtant possible d'attribuer la grande majorite des inscriptions iraniennes et semitiques ä
des personnes residant habituellement ä l'Ouest des Pamirs. On peut en effet difficilement supposer que
les auteurs d'inscriptions palmyrenienne,"" moyen-perses ou bactriennes soient des habitants du Xinjiang.
Or les graffiti qu'ils ont laisses ä Shatial se trouvent sur les memes rochers que les graffiti parthes, syria-
ques et sogdiens et les tamgas dont K. Jettmar et D. König ont montre l'origine sogdienne. Cela permet
de penser que la plupart des inscriptions sogdiennes, dont beaucoup comportent en outre des ethniques
17 7^*a, p. 82.
18 S'appeler Kau! ou Nehru ne signifie pas que l'on soit ne au Cachemire, ni que l'on parle le Kashmiri.
19 FORTE 1995.
20 Pour d'autres exemples, voir la note 53.
21 Sauf si Ton restitue en 54:4.
22 Inscription 33:16; l'identification du langage n'est pas assuree.
respond donc pas necessairement au rassemblement periodique en cet endroit d'un grand nombre de per-
sonnes: il faut d'autres indices pour postuler l'existence d'une foire commerciale et/ou d'un pelerinage.
La determination de l'origine ethnique et geographique des voyageurs pose des problemes difficiles. Les
deux seules inscriptions qui contiennent des toponymes admettent des interpretations contradictoires.^
Lonomastique indique seulement une ascendance, qui peut etre iointaine dans une region d'immigration
et de melange de popuiations comme l'etait la haute valiee de l'Indus.^ Les ethniques peuvent renvoyer
ä un lointain passe: ies Marwaris de Caicutta ont quitte ie Rajasthan ii y a plus de deux siecles, les Pa-
thans et les Moghols de l'Uttar Pradesh vivent en Inde depuis quatre siecles au moins; bien que parfaite-
ment assimiles et integres ä l'administration chinoise, les descendants dAn Shigao ont garde sept siecles
durant l'ethnique "iranien"^'^ etc. Un ethnique peut aussi etre utilise comme sobriquet, pour expri-
mer la relation privilegiee d'une personne avec une contree qui lui est en principe etrangere. Lexemple
type de cet emploi est le surnom Un tel usage peut par exemple expliquer le nom To-
kharaka, "le bactrien" en 39:1 (brähmi) et le nom Induk, "Indien" en 31:97 et 33:12 (sogdien).
Lutilisation d'une ecriture indienne peut egalement etre ambigu. La kharosthl fut utilisee au Gandhära,
mais aussi au Xinjiang. La brähmi et le sanskrit etaient d'usage courant non seulement en Inde Gangeti-
que, mais aussi au Xinjiang et - lorsque la kharosthl fut passee de mode - au Gandhära et dans la haute
valiee de l'Indus; on en a aussi des temoignages en Bactriane. Les inscriptions semitiques et iraniennes,
de meme, ne sont pas necessairement l'oeuvre de voyageurs residant habituellement au Nord ou ä l'Ouest
de l'Hindou-Kouch. Le syriaque a ete vehicule jusqu'en Chine par les communautes chretiennes nestori-
ennes et juives. On a trouve au Xinjiang des textes manicheens rediges en parthe. Quant au sogdien, il
y fut la langue religieuse et d'usage quotidien des communautes expatriees de marchands sogdiens. 11 est
donc impossible, en theorie tout au moins, d'exclure que les auteurs des inscriptions redigees en ces lan-
gues, ou de certaines d'entre eiles, aient habite en territoire aujourd'hui chinois.
11 est souvent possible de deduire du costume d'une personne son origine geographique ou ethnique. Mal-
heureusement, les dessins de Shatial representant des personnes sont ä la fois rares et sommaires. A l'ex-
ception de 17:29, ils ne montrent pas de details qui permettraient d'attribuer une origine precise ä des
vetements (pantalons, tunique ou veste courte, manteau) portes par tous les habitants de la steppe eurasi-
atique, de Palmyre ä Dunhuang, et, depuis les Kouchans, bien attestes en Inde du Nord egalement. De
toute fagon, le dhoti indien n'est pas le costume le plus adapte aux routes du Karakorum. On remarquera
l'absence totale de representation de personnage portant la robe monastique. Ce detail, ajoute au fait que
deux inscriptions seulement comportent le mot b/u'kyn, et aucune un titre monastique,^ laisse supposer
que la plupart des auteurs de graffiti sont des lai'cs.
11 me parait pourtant possible d'attribuer la grande majorite des inscriptions iraniennes et semitiques ä
des personnes residant habituellement ä l'Ouest des Pamirs. On peut en effet difficilement supposer que
les auteurs d'inscriptions palmyrenienne,"" moyen-perses ou bactriennes soient des habitants du Xinjiang.
Or les graffiti qu'ils ont laisses ä Shatial se trouvent sur les memes rochers que les graffiti parthes, syria-
ques et sogdiens et les tamgas dont K. Jettmar et D. König ont montre l'origine sogdienne. Cela permet
de penser que la plupart des inscriptions sogdiennes, dont beaucoup comportent en outre des ethniques
17 7^*a, p. 82.
18 S'appeler Kau! ou Nehru ne signifie pas que l'on soit ne au Cachemire, ni que l'on parle le Kashmiri.
19 FORTE 1995.
20 Pour d'autres exemples, voir la note 53.
21 Sauf si Ton restitue en 54:4.
22 Inscription 33:16; l'identification du langage n'est pas assuree.