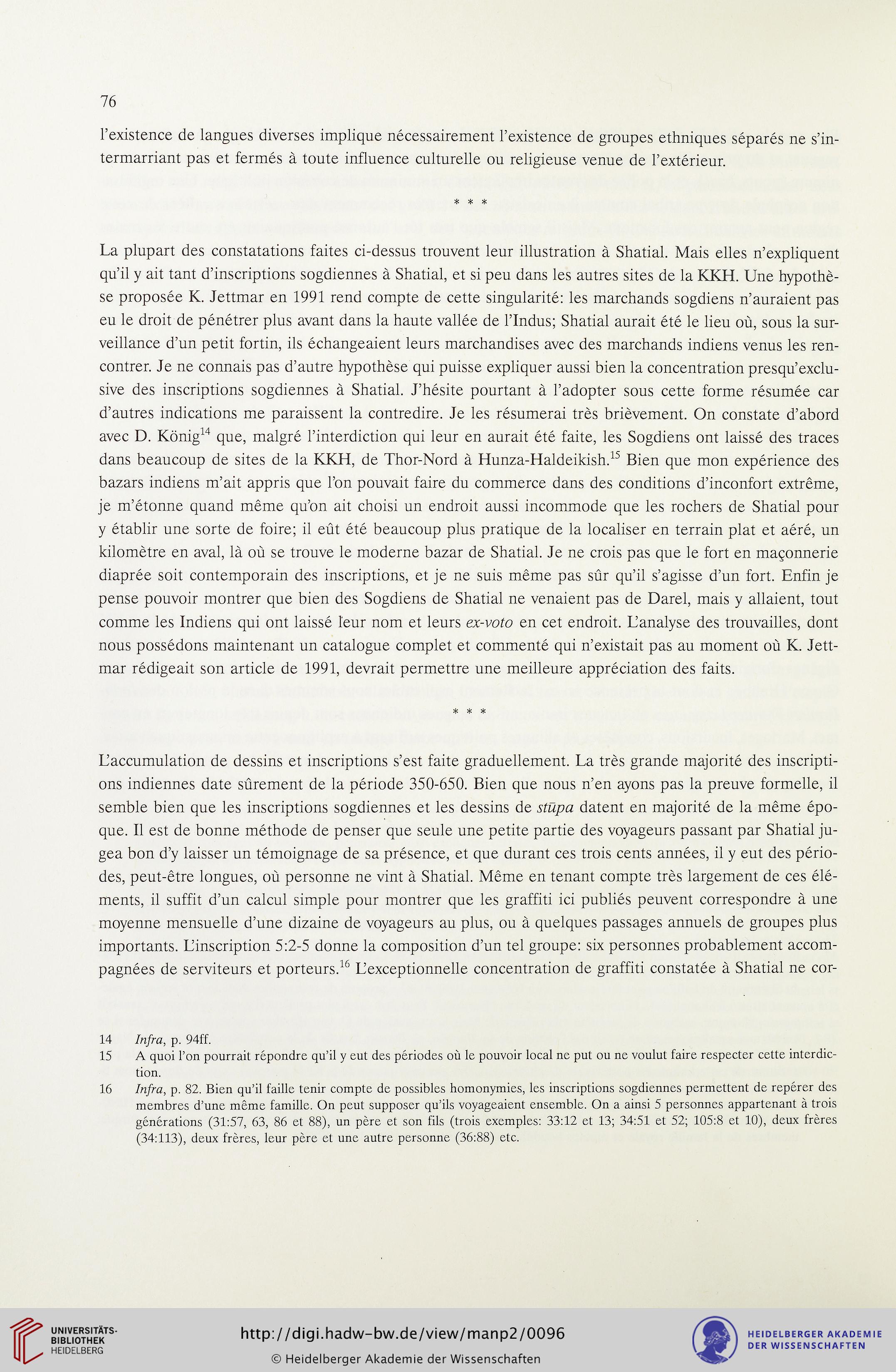76
l'existence de langues diverses implique necessairement l'existence de groupes ethniques separes ne s'in-
termarriant pas et fermes ä toute influence culturelle ou reiigieuse venue de l'exterieur.
La plupart des constatations faites ci-dessus trouvent leur illustration ä Shatiai. Mais eiles n'expliquent
qu'il y ait tant d'inscriptions sogdiennes ä Shatiai, et si peu dans les autres sites de la KKH. Une hypothe-
se proposee K. Jettmar en 1991 rend compte de cette singularite: les marchands sogdiens n'auraient pas
eu le droit de penetrer plus avant dans la haute vallee de l'Indus; Shatiai aurait ete le lieu oü, sous la sur-
veillance d'un petit fortin, ils echangeaient leurs marchandises avec des marchands indiens venus les ren-
contrer. Je ne connais pas d'autre hypothese qui puisse expliquer aussi bien la concentration presqu'exclu-
sive des inscriptions sogdiennes ä Shatiai. J'hesite pourtant ä l'adopter sous cette forme resumee car
d'autres indications me paraissent la contredire. Je les resumerai tres brievement. On constate d'abord
avec D. König^ que, malgre l'interdiction qui leur en aurait ete faite, les Sogdiens ont laisse des traces
dans beaucoup de sites de la KKH, de Thor-Nord ä Hunza-Haldeikish.^ Bien que mon experience des
bazars indiens m'ait appris que lbn pouvait faire du commerce dans des conditions d'inconfort extreme,
je m'etonne quand meme qu'on ait choisi un endroit aussi incommode que les rochers de Shatiai pour
y etablir une sorte de foire; il eüt ete beaucoup plus pratique de la localiser en terrain plat et aere, un
kilometre en aval, lä ou se trouve le moderne bazar de Shatiai. Je ne crois pas que le fort en magonnerie
diapree soit contemporain des inscriptions, et je ne suis meme pas sür qu'il s'agisse d'un fort. Enfin je
pense pouvoir montrer que bien des Sogdiens de Shatiai ne venaient pas de Darei, mais y allaient, tout
comme les Indiens qui ont laisse leur nom et leurs ax-wlo en cet endroit. Lanalyse des trouvailles, dont
nous possedons maintenant un catalogue complet et commente qui n'existait pas au moment oü K. Jett-
mar redigeait son article de 1991, devrait permettre une meilleure appreciation des faits.
Eaccumulation de dessins et inscriptions s'est faite graduellement. La tres grande majorite des inscripti-
ons indiennes date sürement de la periode 350-650. Bien que nous n'en ayons pas la preuve formelle, il
semble bien que les inscriptions sogdiennes et les dessins de datent en majorite de la meme epo-
que. 11 est de bonne methode de penser que seule une petite partie des voyageurs passant par Shatiai ju-
gea bon d'y laisser un temoignage de sa presence, et que durant ces trois cents annees, il y eut des perio-
des, peut-etre longues, oü personne ne vint ä Shatiai. Meme en tenant compte tres largement de ces ele-
ments, il suffit d'un calcul simple pour montrer que les graffiti ici publies peuvent correspondre ä une
moyenne mensuelle d'une dizaine de voyageurs au plus, ou a quelques passages annuels de groupes plus
importants. Linscription 5:2-5 donne la composition d'un tel groupe: six personnes probablement accom-
pagnees de serviteurs et porteurs.^ Eexceptionnelle concentration de graffiti constatee ä Shatiai ne cor-
14 Z/ipY/, p. 9411.
15 A quoi l'on pourrait repondre qu'il y eut des periodes oü le pouvoir local ne put ou ne voulut laire respecter cette interdic-
tion.
16 T/i/ra, p. 82. Bien qu'il laille tenir compte de possibles homonymies, les inscriptions sogdiennes permettent de reperer des
membres d'une meme lamille. On peut supposer qu'ils voyageaient ensemble. On a ainsi 5 personnes appartenant a trois
generations (31:57, 63, 86 et 88), un pere et son lils (trois exemples: 33:12 et 13; 34:51 et 52; 105:8 et 10), deux Ireres
(34:113), deux Ireres, leur pere et une autre personne (36:88) etc.
l'existence de langues diverses implique necessairement l'existence de groupes ethniques separes ne s'in-
termarriant pas et fermes ä toute influence culturelle ou reiigieuse venue de l'exterieur.
La plupart des constatations faites ci-dessus trouvent leur illustration ä Shatiai. Mais eiles n'expliquent
qu'il y ait tant d'inscriptions sogdiennes ä Shatiai, et si peu dans les autres sites de la KKH. Une hypothe-
se proposee K. Jettmar en 1991 rend compte de cette singularite: les marchands sogdiens n'auraient pas
eu le droit de penetrer plus avant dans la haute vallee de l'Indus; Shatiai aurait ete le lieu oü, sous la sur-
veillance d'un petit fortin, ils echangeaient leurs marchandises avec des marchands indiens venus les ren-
contrer. Je ne connais pas d'autre hypothese qui puisse expliquer aussi bien la concentration presqu'exclu-
sive des inscriptions sogdiennes ä Shatiai. J'hesite pourtant ä l'adopter sous cette forme resumee car
d'autres indications me paraissent la contredire. Je les resumerai tres brievement. On constate d'abord
avec D. König^ que, malgre l'interdiction qui leur en aurait ete faite, les Sogdiens ont laisse des traces
dans beaucoup de sites de la KKH, de Thor-Nord ä Hunza-Haldeikish.^ Bien que mon experience des
bazars indiens m'ait appris que lbn pouvait faire du commerce dans des conditions d'inconfort extreme,
je m'etonne quand meme qu'on ait choisi un endroit aussi incommode que les rochers de Shatiai pour
y etablir une sorte de foire; il eüt ete beaucoup plus pratique de la localiser en terrain plat et aere, un
kilometre en aval, lä ou se trouve le moderne bazar de Shatiai. Je ne crois pas que le fort en magonnerie
diapree soit contemporain des inscriptions, et je ne suis meme pas sür qu'il s'agisse d'un fort. Enfin je
pense pouvoir montrer que bien des Sogdiens de Shatiai ne venaient pas de Darei, mais y allaient, tout
comme les Indiens qui ont laisse leur nom et leurs ax-wlo en cet endroit. Lanalyse des trouvailles, dont
nous possedons maintenant un catalogue complet et commente qui n'existait pas au moment oü K. Jett-
mar redigeait son article de 1991, devrait permettre une meilleure appreciation des faits.
Eaccumulation de dessins et inscriptions s'est faite graduellement. La tres grande majorite des inscripti-
ons indiennes date sürement de la periode 350-650. Bien que nous n'en ayons pas la preuve formelle, il
semble bien que les inscriptions sogdiennes et les dessins de datent en majorite de la meme epo-
que. 11 est de bonne methode de penser que seule une petite partie des voyageurs passant par Shatiai ju-
gea bon d'y laisser un temoignage de sa presence, et que durant ces trois cents annees, il y eut des perio-
des, peut-etre longues, oü personne ne vint ä Shatiai. Meme en tenant compte tres largement de ces ele-
ments, il suffit d'un calcul simple pour montrer que les graffiti ici publies peuvent correspondre ä une
moyenne mensuelle d'une dizaine de voyageurs au plus, ou a quelques passages annuels de groupes plus
importants. Linscription 5:2-5 donne la composition d'un tel groupe: six personnes probablement accom-
pagnees de serviteurs et porteurs.^ Eexceptionnelle concentration de graffiti constatee ä Shatiai ne cor-
14 Z/ipY/, p. 9411.
15 A quoi l'on pourrait repondre qu'il y eut des periodes oü le pouvoir local ne put ou ne voulut laire respecter cette interdic-
tion.
16 T/i/ra, p. 82. Bien qu'il laille tenir compte de possibles homonymies, les inscriptions sogdiennes permettent de reperer des
membres d'une meme lamille. On peut supposer qu'ils voyageaient ensemble. On a ainsi 5 personnes appartenant a trois
generations (31:57, 63, 86 et 88), un pere et son lils (trois exemples: 33:12 et 13; 34:51 et 52; 105:8 et 10), deux Ireres
(34:113), deux Ireres, leur pere et une autre personne (36:88) etc.